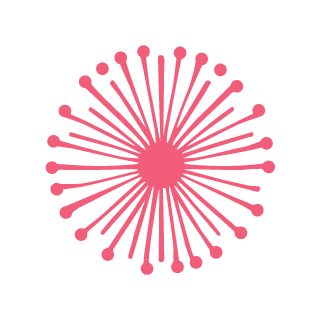Le Jeudi 14 août 2025
La pluralité de villes dans une même ville : les affordances et la cohabitation sociale.
publié par Projet inclusion
Plus qu’une définition officielle, la cohabitation sociale est actuellement une idée mobilisée par certaines institutions, notamment les villes, qui renvoie aux manières dont les individus devraient habiter les espaces urbains afin de « vivre ensemble ». Un vivre ensemble défini selon des normes établies par des représentants élus (les conseiller·ères de ville dans le cas de Montréal), mises en œuvre par des fonctionnaires, et à faire respecter par des acteurs répressifs et judiciaires. Dans ce sens, un rapport a récemment été produit par l’Office de consultation publique de Montréal sur ce thème, sous un mandat de la Ville de Montréal, avec l’objectif de réfléchir à cette cohabitation sociale en tenant compte de la parole de plusieurs acteurs.
L’angle que ce terme a pris, dans le contexte actuel, concerne la relation avec une partie de la population dont l’« habitation » se trouve dans les espaces publics. Ces personnes sont désignées de diverses manières : directement, en utilisant des termes comme les itinérantes, les personnes en situation d’itinérance ; ou indirectement, à travers le phénomène de l’itinérance. Dans les deux cas, cela renvoie, pour une grande partie de la population, à l’image d’un type de personne dont les identités dépassent le fait d’habiter dehors.
À la suite de la publication du rapport, nous trouvons pertinent de partager notre réflexion sur la pratique réelle du vivre ensemble dans les espaces publics, notamment dans le cadre d’une posture d’inclusion.
Les affordances
Pour nous, la compréhension et la pratique de la cohabitation sociale gagneraient à inclure la notion d’affordance : c’est-à-dire les possibilités d’interaction qu’un individu actualise dans un espace donné, qu’il s’agisse d’objets, de normes, de symboles ou de personnes.
Selon la personne et selon l’espace, certaines interactions sont soit nécessaires, soit possibles. La ville peut donc être envisagée comme un espace comportant une pluralité d’affordances, dépendamment des situations vécues par celles et ceux qui l’habitent, et des espaces ou objets en place. L’affordance fait surtout référence à l’interaction émergente entre les individus et leur environnement.
Ainsi, une maison abandonnée devient le nid d’un groupe de pigeons, tandis que pour les propriétaires serait une relation encadrée par les dynamiques de la spéculation financière. Des fils électriques dans la rue devient, pour des oiseaux, des lieux de reproduction; pour une entreprise, un moyen de transport de l’électricité qu’elle consomme ; pour un groupe de personnes, par le geste d’accrocher de souliers, un moyen d’expression. Un sol noir, dur et chaud permet à une personne de se déplacer dans une boîte munie de roues, tandis que pour une autre, cette même dureté devient une surface où dormir.
Une rencontre entre deux personnes peut se vivre avec peur ou avec curiosité, selon les idées qui circulent à propos d’un trait d’identité de l’une ou de l’autre. Les possibilités d’interaction sont façonnées par les ressources physiques, matérielles et symboliques disponibles.
De ce fait, les affordances de la ville pour une personne ayant accès à un logement sont très différentes de celles pour une personne qui n’en a pas. Mais cela ne s’arrête pas là : autant une personne sans logement qu’une personne logée incarne une multiplicité d’autres identités, ce qui rend impossible de les réduire à un seul trait. Dans cette perspective, il n’y a pas une seule ville, mais plusieurs villes, selon les affordances.
Pour une personne, une bouteille dans la rue pourrait être une ordure ; pour une autre, un bien. Pour l’une, un bâtiment serait un refuge, un lieu pour dormir, élever des enfants, cuisiner, satisfaire des besoins physiologiques. Pour une autre, ce même bâtiment ne serait qu’un mur contenant des personnes, ou un lieu inaccessible. La ville peut être tout cela à la fois, ayant donc des expertises multiples qui l’habitent. Pourtant, malgré cette multiplicité, il y a cette tendance à concevoir, nommer et statuer sur une seule affordance dominante, comme si le simple fait de la nommer (ou de la normer) pouvait faire disparaître les autres.
La nature imprévue des affordances
Les affordances ne peuvent pourtant être statués, à moins d’en finir avec la vie elle-même. Il existe, évidemment, des planificateurs qui réfléchissent aux usages des espaces. Mais si l’on tient compte de cette idée d’affordance, ce qui peut réellement être planifié n’est que le passé (même si les termes sont contradictoires) : c’est-à-dire faire une analyse continuelle et à postériori de l’interaction qui a eu lieu entre les espaces et les personnes et l’émergence des affordances. Autrement dit, l’objet, l’espace, la norme, le message mis en place aura des affordances différentes (des possibilités d’action) qui dépendront de l’histoire, de la forme, des sensations, des émotions, de la situation présente vécue par les acteurs en interaction entre eux et avec l’espace.
On regarde un espace en croyant qu’il sera utilisé d’une certaine manière, mais cet espace répond toujours à la multiplicité d’histoires et de vécus qui interagissent avec lui, indépendamment des normes d’usage institutionnelles. Le travail sans fin, voué à l’échec, est de vouloir normaliser l’affordance, et de penser qu’un même espace va générer, par la planification, une même possibilité d’action, indépendamment du contexte. Bien souvent, même avec de bonnes intentions, ce travail débouche sur des pratiques répressives pour tenter de forcer l’utilisation normée, et même là, les affordances résistent. On entendra alors des phrases comme : « vous voyez, on met cela en place, mais les gens ne se laissent pas aider », donc il faut interdire.
Vers une ville inclusive
Comprendre cette idée d’affordance nous a permis de constater que les identités sont multiples, que les compréhensions de l’espace sont plurielles, que la vie se déploie dans l’inattendu, que vouloir contrôler les interactions vivantes est un échec, et qu’utiliser une même formule dans un autre contexte, c’est-à-dire décontextualiser les objets, les messages, les aménagements en pensant qu’ils sont en soi bons est souvent un piège naïf.
Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas avoir des hypothèses sur les affordances possibles qu’un objet, un message ou un aménagement pourrait générer. Mais ces hypothèses, toujours en redéfinition, doivent émerger de l’écoute de la pluralité des histoires, des identités et des situations. Il faut surtout faire une pause dans nos idées, et, dans le cas de la cohabitation, mettre entre parenthèses l’image d’un type de ville que nous avons en tête, pour pouvoir entendre les langages de ces villes qui coexistent dans un même espace.
David Castrillon, directeur générale du Projet inclusion
Crédit photo : Photo de Ana Duque
Lire le rapport “Itinérance et cohabitation sociale à Montréal” de l’Office de consultation publique de Montréal